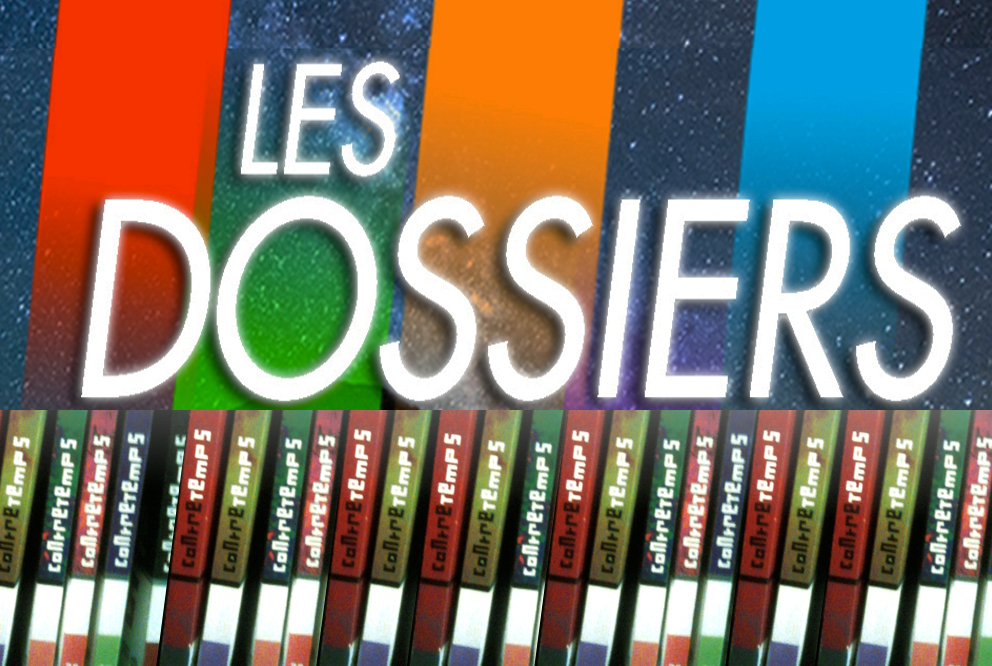
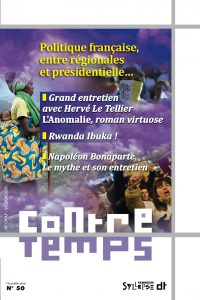 « Seule la vérité traverse le feu sans se consumer »
« Seule la vérité traverse le feu sans se consumer »
(proverbe rwandais)
° Entretien avec Étienne Nsanzimana (*)
(*) Étienne Nsanzimana est Président d’Ibuka France.
ContreTemps : Ces dernières semaines le Rwanda et le génocide dont les Tutsis ont été victimes ont été au cœur de l’attention d’au moins une partie des médias et de l’opinion. Mais en fait, on s’est essentiellement intéressé à la relation de la France avec le Rwanda, et à ce que Fabrice Arfi a caractérisé comme « l’une des pages les plus sombres de l’histoire française » (1).
Étienne Nsanzimana : Nous sommes heureux que le Rwanda fasse la une des journaux, que des émissions de télévision lui soient consacrées, mais il est vrai que c’est au risque de réduire le Rwanda au génocide, voire qu’on s’intéresse exclusivement à la relation de la France à celui-ci. Cela au prix de l’étouffement de tout autre sujet. Ainsi, lors d’un récent colloque organisé par Ibuka à l’Hôtel de Ville de Paris, un jeune journaliste indépendant m’a fait part de sa déception de constater que les articles concernant la présence des génocidaires en France comme en Belgique avaient le plus grand mal à trouver preneur. Ça ne s’intègre pas dans un prisme par trop franco-français.
CT : Avant d’aborder ces questions, pouvez-nous dire où en est le peuple rwandais près de trente ans (une génération) après cet immense traumatisme ?
É. N. : Le pays est toujours dans la réparation des séquelles du génocide. On a dit souvent que la mémoire d’un génocide est une mémoire paradoxale : plus le temps passe, moins on oublie… Des détails qui avaient d’abord été occultés reviennent, dans une lumière plus crue. Reste que le Rwanda se relève, il ne veut pas être défini par ce génocide dont il porte les stigmates. En effet en permanence on croise des personnes que les coups de machette ont marquées, d’autres qui souffrent de graves troubles psychiques. On n’est plus dans la mémoire immédiate, mais pas non plus dans une mémoire apaisée.
La chance que nous avons est que le Rwanda dispose d’un État qui fonctionne, ce qui permet de mener le travail de réparation. S’il en avait été autrement, avec un État en faillite, le Rwanda n’aurait pu se relever et je n’ose imaginer quel aurait été le rôle des rescapés. La société est très organisée, les services de base sont plus efficaces que dans d’autres pays africains, des perspectives d’avenir existent ce qui permet de rêver.
Faute de ressources minières, qui peuvent être une bénédiction mais aussi une malédiction, le pays mise sur le troisième secteur de l’économie, cherche à s’intégrer dans la région et au-delà. Il le fait avec les moyens qui sont les siens, avec de bons résultats dans certains secteurs, moins bons dans d’autres. La croissance est soutenue, et comme il n’existe pas beaucoup d’aides publiques les gens travaillent énormément, pour tenir des horaires soutenus, suivre des cours du soir…
C’est un pays qui en veut, qui a échappé au risque de la disparition.
CT : A-t-il été touché par le Covid ?
É. N. : Le pays a été touché, mais beaucoup moins que d’autres. Alors que 200 cas étaient enregistrés, la réaction a été immédiate avec couvre-feu à 21 heures et mesures de précaution très respectées de la part d’une population qui se montre très disciplinée. Hier soir j’étais avec des amis tout juste arrivés de Kigali, ils se sont montrés choqués de croiser des gens ne portant pas le masque ou peu soucieux de respecter le couvre-feu.
Le Covid a fait moins de dégâts que dans d’autres pays. Ce que reconnaît l’U.E. qui a mis le Rwanda sur la liste verte, seul pays africain dont les ressortissants sont admis sur son territoire.
Donc un signe positif que le pays fonctionne, ce qui permet d’affronter d’autres difficultés de la vie.
CT : Accède aujourd’hui à l’âge adulte une jeunesse née après le génocide, la transmission mémorielle entre générations se fait-elle ?
É. N. : C’est une question que je me pose. Lors de rencontres avec des étudiants, je ne peux m’empêcher de leur demander leur âge, et de constater qu’ils sont nés après le génocide. Pourtant la transmission se fait. Sans doute parce que le génocide est présent dans l’espace public, avec ces maisons non reconstruites parce qu’elles appartenaient à des familles qui ont été totalement décimées, il y a sur des murs les traces des balles, et bien sûr les mémoriaux, celui de Kigali, et d’autres dans les villages, aussi les stèles au bord des lacs où ont été noyées des victimes sans noms… La terre porte ces blessures, et la transmission se fait aussi par la topographie. Reste à contextualiser. Car les gens ne se sont pas réveillés en colère un matin pour décider d’aller tuer leurs voisins. Il s’est agi d’une lente construction. C’est cela qu’il est important d’expliquer à la jeunesse.
CT : Des génocidaires sont présents au sein de la population ?
É. N. : La proximité immédiate avec les auteurs des massacres, c’est du jamais vu. On peut croiser chaque matin celui qui a tué ses parents, ou une femme qui porte le pagne de sa mère assassinée… Autant de scènes difficilement concevables.
Beaucoup de génocidaires qui avaient fui au Congo progressivement sont ensuite revenus. Sans toujours avoir l’intelligence de s’installer loin du lieu où ils avaient perpétré des massacres et à l’écart des éventuels témoins survivants. Certains sont tombés sur quelqu’un qui a pu témoigner et apporter les preuves des crimes, dans ce cas la mise en œuvre de la justice permet aux rescapés un début de reconstruction. D’autres génocidaires sont revenus dans des endroits où personne n’ayant été épargné il n’y a plus de témoins, le crime parfait en quelque sorte, donc ils ont pu se réinstaller dans leurs maisons, celles-ci n’ayant pas été détruites, et vivre tranquillement leur vie, sans que personne ne puisse les accuser de quoi que ce soit. Pour les victimes c’est alors un malheur insondable, de voir les bourreaux prospérer, alors que leur famille à eux a été décimée.
Une telle situation pèse lourd sur les consciences, voire les inconscients, par exemple pour ceux qui sont partis et ne veulent plus revenir au Rwanda par peur d’être confrontés à ces gens, à ces lieux devenus hostiles.
Des organisations de soutien aux rescapés ont fait montre d’une réelle efficacité. C’est le cas d’Ibuka, ou de l’Association d’aide aux veuves (AVEGA). Il faut savoir que les femmes étaient majoritaires dans le pays et qu’en outre le génocide a principalement frappé les hommes, on arrachait les garçons des bras de leurs mères pour infliger à celles-ci une souffrance extrême. Beaucoup de femmes n’y ont pas survécu. Les associations ont travaillé à soutenir ces veuves.
CT : Ibuka, « souviens-toi ! », est le nom de l’association que vous présidez…
É. N. : Ibuka existe au Rwanda, et en Europe, d’abord en Belgique, en Suisse, aux Pays Bas, en France, à présent en Allemagne. Les politiques menées répondent à des contextes différents, mais l’esprit est le même. Il s’agit d’apporter du soutien, par exemple en période de covid, d’échanger lors des commémorations, de planifier les calendriers mémoriels. Cela pour répondre à une demande forte des rescapés. Ainsi lors d’une rencontre zoom on constate que les participants n’ont plus envie de se quitter, même au bout de trois heures d’échanges. Il y a un besoin de se parler entre gens qui se comprennent. Les témoignages destinés à un public étranger sont très importants, il faut transmettre, mais les rescapés ont besoin de se retrouver entre eux, c’est comme un baume au cœur. On se repose sur les autres, l’un peut finir la phrase que l’autre a commencée, on se comprend à demi mot, car on a vécu quelque chose de fondateur.
Le génocide est à l’origine d’un nouveau vocabulaire, qui a été inventé soit par les bourreaux, soit par les rescapés pour désigner des réalités qui n’existaient pas avant. Ainsi le mot génocide n’existait pas, l’entreprise génocidaire elle-même a été préparée de longue date, mais de manière cachée, donc sans ce mot. Il a fallu inventer en kinyarwanda le mot jenoside.
CT : Ce Souviens toi !, de quoi est-il porteur ?
É. N. : C’est une injonction vers l’extérieur, mais aussi pour nous. Un pacte de ne jamais oublier. Car il est important de savoir. Chaque rescapé est le gardien de l’autre. Sans jamais avoir demandé à un ami « Comment ça s’est passé pour toi ? », parfois des années après, en un moment inattendu, le souvenir surgit : « On était ensemble dans cette église. Je me suis échappé. Lui n’a pas réussi à fuir car on lui avait sectionné les tendons… » On part alors dans un récit où vont se dire des choses qu’on ignorait, à propos desquelles on n’avait jamais eu l’idée d’interroger.
CT : Venons-en au côté français. Avec le rapport Duclert et le discours d’Emmanuel Macron à Kigali, après tant d’années de dénégations, de ruses et de mensonges, il est enfin dit que la France porte une « responsabilité accablante » dans le génocide des Tutsis du Rwanda. Comment cette reconnaissance est-elle comprise par les Rwandais, n’est-ce pas trop tard, est-ce suffisant ?
É. N. : Du rapport Duclert nous avons d’abord lu les douze pages de conclusion, et ces mots de « responsabilité accablante » nous les avons jugés forts.
Il est vrai que ce rapport a été accueilli différemment selon les attentes des gens. Certains n’espéraient plus rien, estimaient que la France continuerait à camper sur un récit niant la réalité. Ceux-là ont été surpris et rassurés. D’autres estimaient qu’il fallait aller plus loin, et ils ont été déçus.
Pour nous, dans notre rôle de défense de la mémoire des victimes du génocide, nous avons estimé que le rapport répondait à plusieurs exigences. Auparavant il y avait eu les travaux des chercheurs, des historiens, des journalistes, mais extérieurement à toute parole officielle. Cette fois il s’agit d’un rapport commandé par le président de la République, qui lui a été remis et qu’il a accepté. Donc un cap a été franchi.
Jusque-là ceux qui disaient ce qui est écrit dans le rapport se voyaient accusés d’être l’anti-France, désignés comme des irresponsables, des individus gênants, et contre lesquels on pouvait intenter des procès. Cette fois c’est écrit noir sur blanc, et il s’agit d’un narratif officiel. Certains rescapés ne pensaient pas voir cela de leur vivant.
Le rapport Duclert a été suivi d’un rapport américain qui va dans le même sens. C’est à saluer : les historiens ont fait leur travail. Aux politiques de faire le leur !
Pour notre part, nous maintenons des critiques, ainsi nous n’acceptons pas le mot « aveuglement », que ne justifie pas par ce qui est décrit sur des dizaines de pages. Quant au mot « complicité » qui est écarté, ce dont s’est saisi Hubert Védrine pour prétendre que le pouvoir de l’époque s’en trouve innocenté, ce sera davantage aux juristes d’en décider, plutôt qu’aux historiens. Fournir des munitions à qui commet le crime, difficile de penser que « l’absence d’intention criminelle » vaut acquittement…
CT : La formule finement ciselée d’Emmanuel Macron « Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don alors de nous pardonner », vous apparaît-elle en mesure de répondre aux attentes du côté rwandais, permettre comme l’a dit le président Paul Kagame dans entretien du Monde (2), de parvenir « à une forme d’épilogue et qu’une nouvelle situation émerge » ?
É. N. : Donc la charge du pardon repose sur les rescapés ! Certes la formule est bien tournée. Le président français en amont de son discours a prononcé des mots, a adopté des attitudes consistant à s’adresser non aux autorités mais aux rescapés… Tout cela a été très bien reçu.
Au demeurant il s’agit d’un proverbe rwandais, ijoro ribara uwariraye. En fait, des excuses n’auraient pas apporté grand-chose de plus.
L’important a été de dire que le génocide ne se termine jamais. À présent, il faut en tirer les conséquences, traduire en justice les génocidaires, accélérer les procédures, s’en donner les moyens. Le génocide c’est aussi pour une part une histoire française, dans ce crime contre l’humanité la France porte une responsabilité plus grande que d’autres pays. Il faudrait qu’il prenne une juste part dans les manuels scolaires, que sa mémoire s’inscrive dans l’espace public, la date du 7 avril est officiellement reconnue, mais il faut que les paroles fortes prononcées à Kigali s’inscrivent dans la réalité. Le rôle de la société civile est d’y veiller.
CT : Sans doute se tromperait-on si on croyait qu’en France on est parvenu à une compréhension commune des responsabilités dans cette tragédie. Celles-ci renvoient à un héritage qui reste en partie tabou pour le Parti socialiste et une bonne partie de la gauche, qui est celui de la présidence de François Mitterrand. Les quelques proches qui ont alors accompagné ses choix, même aujourd’hui ne renoncent pas à défendre l’indéfendable. Hubert Védrine, on vient de l’évoquer, s’évertue à souligner que le rapport Duclert écarte le mot « complicité » pour tenter d’occulter celui de « responsabilité écrasante », Bernard Cazeneuve regrette que les conclusions du même rapport « témoignent d’une approche peu nuancée » ( 3).
À l’extrême droite on ne se gêne pas pour dénoncer le discours de Macron à Kigali : Marine Le Pen évoque une France qui « s’abaisse (…) quand elle se flagelle pour des fautes qui ne sont pas les siennes », et le polémiste Ivan Rioufol explique : « L’urgence est de rejeter le masochisme et l’hébétude, ces poisons de la politique. Masochisme quand Emmanuel Macron reconnaît la « responsabilité » de la France au Rwanda, même s’il ne prononce pas d’excuses, dans le génocide interracial dont elle n’a pourtant pas été complice ; cette tragédie ethnique n’a concerné que les seuls Hutus et Tutsis. » (4) Quel regard portez-vous sur ce type de propos et sur ce qu’ils ont de révélateur ?
É. N. : Tout le spectre politique a en effet été amené à dire son mot. C’est positif. Que les langues se délient permet de voir les positions de chacun. Certains sont très gênés, du côté du Parti socialiste, car ils comprennent que le vent de l’histoire a tourné, qu’on ne peut plus échapper à un examen de conscience.
Il ne faut pas non plus oublier que ces événements ont eu lieu dans une période de cohabitation, ce qui explique pour une part le blocage qui a dominé jusque-là, du fait que tous étaient dans le même bateau. Il a fallu un président suffisamment jeune pour avoir été étranger à tout cela et être en capacité de bousculer le système.
Malgré tout il faut noter que suite au rapport Duclert il n’a été posé aucune question à l’Assemblée nationale. Signe des limites de l’intérêt porté à un aussi dramatique sujet.
Quant à ceux que vous citez à l’extrême droite, on voit comment ils jouent sur la mauvaise conscience française, voire la mauvaise foi, par exemple lorsque Éric Zemmour explique sur C News qu’il ne faut pas exagérer ce qui s’est fait, et que c’était… « au nom de l’intérêt de la France » ! On est dans le registre de « la vérité, une opinion comme une autre », des « faits alternatifs » façon Trump. Tout cela c’est passé en Afrique, donc on évoquera des « conflits inter-ethniques », voire des génocides au pluriel (la thèse du « double génocide »). Régulièrement nous mettons en garde à propos de la formule « génocide rwandais », il n’y a pas de génocide des Rwandais, mais un génocide des Tutsis, c’est là une facilité qui alimente les confusions, et au pire prête au négationnisme.
CT : Vous êtes intervenu au nom d’Ibuka le 18 avril dernier lors du rassemblement commémorant le massacre du ghetto de Varsovie et la mémoire de la Shoah, au cours duquel est également intervenu un responsable arménien pour évoquer le génocide des Arméniens… Selon vous, quelle place doit être donnée au génocide des Tutsis au regard de ces autres crimes contre l’humanité, de quelles leçons peut-il être porteur ?
É. N. : Je me souviens d’une intervention dans un collège aux côtés d’un survivant de la Shoah, très âgé, et qui en m’écoutant m’a interrompu pour me dire : « C’est vrai ? », « Ça s’est passé ainsi ? », et a ajouté : « Ça me rappelle ce que j’ai vécu en Pologne ».
À l’école, les Tutsis n’étaient pas traités comme les autres, ils subissaient des humiliations, n’avaient pas droit à une bourse, l’armée leur était interdite, on les qualifiait de cafards ou de serpents. Puis on a inventé un danger potentiel dont ils seraient porteurs, pour convaincre le peuple qu’il lui fallait se défendre face à ce danger. Ce sont là autant de similitudes avec les autres génocides.
Quant aux spécificités, il faut souligner qu’il fut le plus rapide de l’histoire, et surtout ce que j’ai déjà évoqué : la proximité entre les bourreaux et les victimes. Au sein du peuple rwandais il n’y avait aucune séparation structurelle : même religion, niveaux sociaux assez comparables, une langue unique, nombreux mariages mixtes… C’était un bloc difficilement dissociable. D’où l’importance des cartes d’identité, sur lesquelles étaient notées quatre catégories : hutu, tutsi, twa, naturalisé… Si on était tutsi, les 3 autres étaient barrés, une carte d’identité difficilement falsifiable et dont il fallait impérativement disposer pour la présenter aux contrôles… Ainsi difficile d’échapper aux tueurs !
C’est aussi cette réalité qui explique la cruauté des massacres, des souffrances infligées aux victimes, pour dissocier celles-ci de leurs voisins, de personnes si semblables. Pour séparer ce qui ne devait pas l’être.
Propos recueillis par
Francis Sitel
Notes :
(1) : Fabrice Arfi, « Le génocide des Tutsis au Rwanda et l’honneur perdu de la gauche en France », Mediapart, 6 juin 2021.
(2) : Le Monde, 19 mai 2021.
(3) : Le Monde, 19 mai 2021.
(4) : Le Figaro, 4 juin 2021.


